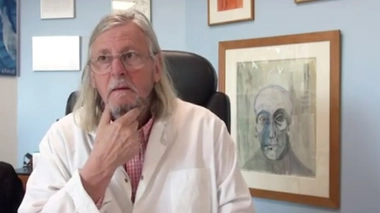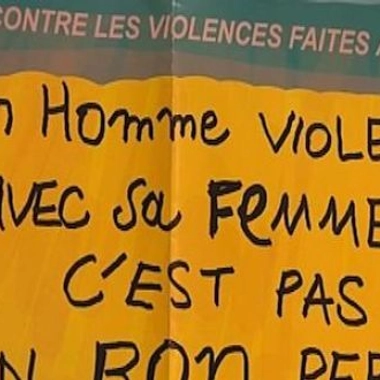Viol : quelle prise en charge pour les victimes ?
Près de 100 000 femmes seraient victimes de viol ou de tentative de viol chaque année en France. Qu'en est-il du suivi psychologique des victimes ? Quelles ressources existent ? Comment se remettre d'un tel traumatisme ?
Par La rédaction d'Allo Docteurs
Rédigé le , mis à jour le
Allodocteurs - Newen France
"Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise." C'est ainsi que le Code pénal français définit le viol. Il s'agit d'un crime puni par la loi et l'auteur d'un tel acte encourt jusqu'à 15 ans de prison.
L'agression sexuelle quant à elle est définie comme une atteinte sexuelle sans pénétration commise sur une personne sans son consentement. Il s'agit d'un délit puni par la loi.
Pourquoi parle-t-on de sidération lors d'un viol ?
Sur le plan cérébral, dès le début d'une agression, notre système d'alarme cérébral, l'amygdale (chargée de décoder les émotions et les stimuli de menace), s'active et déclenche une cascade de réactions pour préparer notre fuite.
Elle provoque, entre autres, la production par les glandes surrénales des hormones du stress, l'adrénaline et le cortisol. Résultat : tout l'organisme est sous tension, le flux sanguin, le rythme cardiaque et la respiration s'accélèrent, les muscles sont contractés, prêts à amorcer la fuite.
Mais quand la victime est immobilisée par son agresseur et ne peut pas s'enfuir, très vite l'amygdale cérébrale s'affole ; les centres nerveux au niveau du cortex, sensés analyser et modérer les réactions, sont comme noyés par les signaux d'alerte. C'est la panique totale. L'amygdale surchauffe, la victime est dans un état de sidération. Résultat : elle ne peut plus se défendre ni crier ni même réagir... Elle est comme paralysée, elle est dans un état de stress extrême dépassé et sent qu'elle va mourir.
Alors, pour éviter que le survoltage de l'amygdale ne provoque un arrêt cardiaque, le cerveau déclenche une sorte de court-circuit, en libérant des substances chimiques, de la morphine et de la kétamine, qui vont isoler le système d'alarme. La production d'hormones de stress est alors stoppée.
La victime est comme coupée du monde, déconnectée de ses émotions. Pourtant, la violence continue, mais elle ne ressent presque plus rien, ce qui lui donne un sentiment d'irréalité totale. Les victimes le disent : à un moment donné, elles ont l'impression d'être spectatrices de l'événement.
C'est cette dissociation qui va leur permettre de rester en vie, mais qui, paradoxalement, va provoquer le sentiment de culpabilité et bien d'autres conséquences. Car isolée, anesthésiée par les décharges de morphine et de kétamine, l'amygdale n'évacue pas le traumatisme du viol vers l'hippocampe, notre système de mémorisation et d'analyse des souvenirs.
Le moment du viol reste comme piégé en l'état dans l'amygdale. Ainsi, à chaque flash-back, c'est le souvenir du viol non traité par le cerveau que va revivre la victime, un moment extrêmement violent. C'est ce que l'on appelle le stress post-traumatique.
Viol et agressions sexuelles : comment porter plainte ?
La police est souvent le premier contact des victimes qui portent plainte. En effet, toute personne victime d'agression sexuelle en France peut alerter les
services de secours et porter plainte à la police ou à la gendarmerie.
Pour déposer plainte, vous pouvez vous rendre physiquement dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. Votre plainte sera ensuite transmise au procureur de la République par ces forces de l'ordre. Vous pouvez également porter plainte par courrier, en envoyant un courrier au tribunal judiciaire du lieu où le viol a été commis ou du domicile de l'auteur du crime. Un modèle de courrier est disponible sur le site Service-public.fr.
Vous disposez d'un délai de 20 ans à compter de la date des faits pour déposer plainte. Après ce délai appelé délai de prescription, votre plainte ne sera plus recevable. Pour les agressions sexuelles, ce délai est de six ans.
L'examen médical des victimes de viol
Comment les victimes de viol sont-elles actuellement prises en charge ?
Si le viol est clairement considéré comme un crime depuis une trentaine d'années, les mentalités évoluent lentement : seule une victime sur dix ose porter plainte.
Après avoir porté plainte dans un service de police, les victimes de viol doivent procéder à un examen médical. Après un entretien avec une infirmière de l'unité médico-judiciaire, un examen médical et gynécologique est réalisé, ainsi que des prélèvements, un test de grossesse et un test HIV notamment. Le but est de dépister d'éventuelles pathologies et de mettre en place des traitements le plus rapidement possible.
Pour avoir accès à une prise en charge médicale et psychologique digne de ce nom, les victimes de viol doivent d'abord porter plainte.
Une ligne téléphonique pour les victimes de viol
Pour venir en aide aux victimes de violences sexuelles, le Collectif féministe contre le viol tient une permanence téléphonique "Viols Femmes informations". Cette permanence nationale fonctionne du lundi au vendredi de 10h à 19h. Le numéro anonyme et gratuit est le 0 800 05 95 95.
Chaque jour des dizaines d'appels arrivent sur cette ligne téléphonique du Collectif féministe contre le viol. Juristes, conseillères conjugales, assistantes sociales… Les écoutantes sont disponibles pour accompagner et guider les victimes. "Notre travail est d'écouter les victimes qui n'ont pas beaucoup d'espace d'expression pour évoquer ces sujets. Notre rôle est de soutenir ces personnes et de remettre les choses à l'endroit. Quand les victimes nous racontent les viols, elles nous racontent tout à l'envers, elles culpabilisent, elles ont l'impression d'avoir mal fait… Notre rôle est donc de remettre les choses à l'endroit et de comprendre la stratégie de l'agresseur", confie Julie, une écoutante de la ligne Viols Femmes informations.
Au fil des appels, les écoutantes aident les victimes à sortir de leur isolement et à parler. Elles les orientent également vers des soignants pour une prise en charge psychologique mais aussi vers des groupes de parole ou des consultations juridiques.
Se reconstruire après un inceste
Le mot "inceste" vient du latin incestus, qui signifie impur, souillé, sacrilège. Dans le dictionnaire, on définit l'inceste comme "une relation sexuelle entre membres d'une même famille et soumise à l'interdit". Un sujet qui reste tabou alors qu'en France, deux millions de personnes auraient été victimes de violences sexuelles incestueuses, parmi lesquelles une grande majorité de femmes mais aussi des hommes.
Pour pouvoir se reconstruire après un inceste, les victimes ont besoin de parler à leur thérapeute, bien sûr, mais elles peuvent aussi avoir envie de se rendre à des groupes de paroles, rassemblant des personnes ayant vécu le même traumatisme. L'AIVI - association internationale des victimes de l'inceste – organise tous les mois dans plusieurs villes de France des groupes de paroles.
S'exprimer, écouter, partager… c'est ce que viennent chercher les victimes d'inceste dans les groupes de paroles. L'animatrice n'est pas une thérapeute mais une survivante de l'inceste comme on dit dans l'association. Dans ces groupes, on parle de tout, même du plus intime et du plus douloureux : la sexualité. Le temps pour se reconstruire est nécessairement long pour que la parole se libère et permette enfin de vivre.
Suite à ces groupes, des livres regroupant des témoignages de victimes sont édités. Pour s'inscrire à ces groupes de paroles, vous pouvez vous rendre sur le site de l'association internationale des victimes de l'inceste.
En savoir plus
Sur Allodocteurs.fr
· Comment retrouver une sexualité épanouie après des violences sexuelles
· À partir de quand peut-on parler de viol ?
· Violences sexuelles : comment s'en remettre ?
· Drogue du violeur : qu’est-ce que la soumission chimique ?
· Agressions sexuelles : quelles conséquences psychologiques sur les enfants ?
· Victime d'inceste : une prise en charge à 100%
· Huit viols sur dix sont commis par des proches
· Ados : comment leur parler des violences sexuelles ?
· Violences sexuelles : une ligne téléphonique pour aider les victimes
· Pourquoi les victimes ne se débattent-elles pas lors d'un viol ?
Ailleurs sur le web
· Collectif féministe contre le viol
· Le Planning familial
· Arrêtons les violences (site du gouvernement)
· Numéro national de référence d’écoute téléphonique et d’orientation à destination des femmes victimes de violences : 3919
· Ministère de l'intérieur