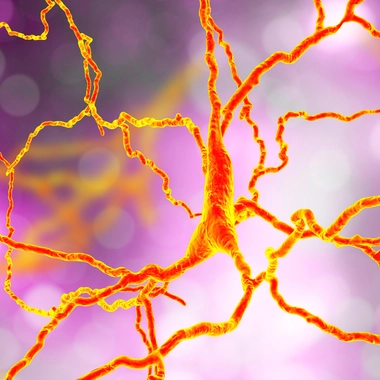Pourquoi bâille-t-on ? Est-ce que tout le monde bâille ? On vous dit tout sur le bâillement
Le bâillement est un phénomène étrange et fascinant, que nous partageons avec une grande majorité des espèces vivantes. Ses mécanismes sont pourtant complexes et encore mal connus.
Par Rym Ben Ameur
Rédigé le
Pourquoi baille-t-on ?
Le Mag de la Santé - France 5
Chaque jour, un être humain bâille spontanément entre cinq et dix fois en moyenne. Un nombre qui peut grimper jusqu’à 20 les jours de grande fatigue. Ce phénomène, aussi soudain qu’incontrôlable, surgit souvent aux moments les plus inattendus, comme en pleine réunion ou en pleine conversation.
À lire aussi : Elle bâille à s’en décrocher la mâchoire… littéralement !
Comment fonctionne le bâillement ?
Ce réflexe n’est pourtant pas l’apanage des adultes. Dès les premiers stades de développement, les fœtus eux-mêmes bâillent dans le ventre de leur mère, comme on peut le voir grâce à certaines échographies. Chez les animaux, le bâillement est aussi largement partagé. On l’observe chez les lions, les chevaux, les crocodiles, les serpents… mais étrangement, pas chez la girafe. L’absence de bâillements chez cet animal intrigue les scientifiques, qui avancent l’hypothèse que cela pourrait être lié à sa morphologie ou à la particularité de son rythme de sommeil.
Longtemps associé à l’ennui ou à la somnolence, le bâillement remplit en réalité une fonction bien différente. D’après la docteure Clara Blanquis, spécialiste du sommeil, il ne s’agit pas d’un signal de fatigue annonçant l’endormissement, mais plutôt d’un mécanisme d’activation. Bâiller stimule en effet une région du cerveau impliquée dans la vigilance. Ce mini-réveil naturel a pour effet d’augmenter l’attention et de redonner un coup de fouet à notre niveau d’éveil. Par ailleurs, le bâillement peut aussi se déclencher en réponse au stress. Dans les situations à enjeu, comme avant un examen, une prise de parole en public ou une compétition sportive, il jouerait un rôle de régulateur émotionnel.
Pourquoi le bâillement est-il contagieux ?
Un autre aspect fascinant du bâillement est sa contagion. Une simple observation suffit à en déclencher un chez soi. C’est ce qu’on appelle l’échokinésie du bâillement. Elle est rendue possible par l’activation des neurones miroirs, ces cellules cérébrales qui réagissent à l’observation des comportements d’autrui. Ces mêmes neurones sont impliqués dans l’imitation, mais aussi dans l’empathie, soit la capacité à se mettre à la place de l’autre. C’est d’ailleurs pour cette raison que 75 % des êtres humains seraient sensibles au bâillement des autres : ils ont la capacité de lire les émotions et de synchroniser leur comportement avec celui de leur entourage.
Chez certaines personnes, l'empathie est plus faible, en particulier chez certains individus atteints de troubles du spectre autistique. Leur réactivité aux bâillements d’autrui est souvent altérée, ce qui pourrait être lié à un fonctionnement différent de leurs neurones miroirs. Selon certaines théories, l’origine du bâillement pourrait remonter à notre évolution et à l’homme préhistorique. Lorsqu’un membre du groupe bâillait, cela pouvait être interprété comme un signal de relâchement de la vigilance. Les autres individus se mettaient alors à bâiller à leur tour pour se réveiller collectivement et rester attentifs face à un danger potentiel.
Chez les animaux, ce phénomène de contagion a été observé chez certains chiens et chez les primates. Des espèces également capables de ressentir de l'empathie. Il existe même une autre expression populaire liée au bâillement, celle de "bailler à s’en décrocher la mâchoire". Une expression qui a du vrai : dans de rares cas, un bâillement particulièrement ample peut entraîner une luxation de la mâchoire et provoquer des douleurs intenses et un blocage de la mâchoire, qui nécessite alors une prise en charge médicale.