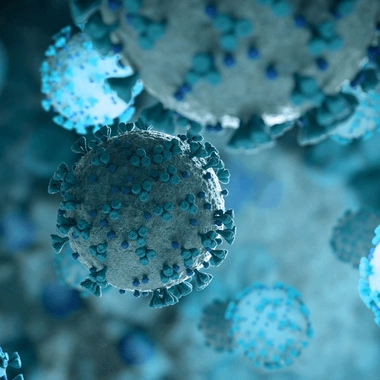Parkinson : stupeur et tremblements
Maladie évolutive et incurable, la maladie de Parkinson se soigne avec des médicaments, la chirurgie via la stimulation profonde ou la pompe à apomorphine. La recherche laisse entrevoir des espoirs de traitements, avec la thérapie génique.
- Quels sont les symptômes de la maladie de Parkinson ?
- Que se passe-t-il dans le cerveau ?
- La prise en charge des patients parkinsoniens
- Traitements : ils ne s'attaquent qu'aux symptômes
- L'activité physique contre Parkinson
- La chirurgie : réservée aux cas les plus graves
- La pompe à apomorphine, en cas d'échec des traitements
- Parkinson : la thérapie génique, un espoir
- Injections de dopamine, vaccin, cellules souches...
- En savoir plus
Marina Carrère d'Encausse et Régis Boxelé vous montrent comment la maladie de Parkinson affecte le cerveau
Tremblements, lenteur dans les déplacements et raideurs musculaires... Ce sont les signes les plus visibles de la maladie de Parkinson. En France, plus de 270.000 personnes sont touchées par cette maladie d'après France Parkinson. 25.000 cas sont diagnostiqués chaque année. 1 personne sur 50 sera directement concernée, par la maladie ou parce qu'elle touche un proche.
Le diagnostic est posé en moyenne vers l'âge de 58 ans mais des patients plus jeunes sont aussi concernés. Aucun traitement ne permet pour l'instant d'en guérir mais de nombreuses avancées ont permis d'améliorer la vie quotidienne des patients.
La maladie de Parkinson fait partie des maladies dites "neurodégénératives". Les neurones de zones spécifiques du cerveau disparaissent de façon irréversible. La substance noire et le striatum sont deux régions qui communiquent grâce à la présence d'un réseau de neurones. Les informations sont transmises par l'intermédiaire d'un messager chimique, la dopamine. La dopamine régule notamment l'activité des neurones qui contrôlent la contraction des muscles et des mouvements. Or, dans la maladie de Parkinson, les neurones à dopamine sont attaqués.
Normalement, les cellules microgliales sont chargées de les protéger des attaques extérieures. Mais en cas de Parkinson, ces cellules de défense ne les reconnaissent plus et les attaquent en libérant des molécules tueuses. Elles vont se fixer sur les neurones malades et les faire disparaître. Problème, les neurones sains à proximité vont eux aussi disparaître.
Quels sont les symptômes de la maladie de Parkinson ?
Conséquence de cette dégénérescence : il y a moins de neurones donc moins de dopamine. Sans ce messager, la contraction des muscles n'est plus parfaitement contrôlée, d'où les signes caractéristiques de la maladie de Parkinson : raideur des muscles, lenteur et difficulté des mouvements (akinésie).
On note aussi des signes de tremblements lorsque la personne est au repos. D'autres symptômes sont possibles : troubles de l'élocution, de l'écriture, du sommeil, de l'équilibre, cognitifs. Une anxiété ou une dépression peuvent également être observées.
Que se passe-t-il dans le cerveau ?
Dans la maladie de Parkinson, ce sont précisément les neurones dopaminergiques qui sont touchés. Sans qu'on sache expliquer pourquoi, des protéines s'agrègent à l'intérieur du corps neuronal et forment ce qu'on appelle les corps de Lewy. Puis, les neurones disparaissent. Quand un grand nombre de neurones de la substance noire ont disparu, le striatum se retrouve "en manque" de dopamine. Chez une personne en bonne santé, l'activité dopaminergique est visible dans la striatum grâce à un processus de radioactivité. Chez une personne atteinte de la maladie de Parkinson, il y a beaucoup moins de dopamine.
Le striatum ne peut plus assurer ses fonctions et les symptômes cliniques de la maladie apparaissent. Il s'agit surtout des signes moteurs, avec une "triade" caractéristique : tremblements, ralentissement des mouvements (bradykinésie) et rigidité musculaire. Des signes associés aussi à des troubles du sommeil, des symptômes dépressifs, avec perte de motivation et une grande fatigue. Et dans 80% des cas, après quelques années d'évolution de la maladie, des difficultés intellectuelles finissent par apparaître.
La prise en charge des patients parkinsoniens
Les conseils des différents spécialistes permettent à Anne-Marie d'améliorer son quotidien.
La maladie de Parkinson est évolutive et irréversible. Elle progresse de manière plus ou moins lente, en fonction des malades. Les symptômes varient aussi d'un jour à l'autre, l'intensité du tremblement, de la lenteur ou de la raideur, est fluctuante en fonction des moments. Des troubles de l'équilibre, de la mémoire et du sommeil sont également possibles.
Le neurologue est au coeur de la prise en charge médicale, initie le traitement par médicaments et évalue son efficacité. Il peut décider aussi de la possibilité d'une chirurgie (stimulation cérébrale profonde). Le généraliste coordonne la rééducation et la prise en charge des symptômes non moteurs avec par exemple des séances d'orthophonie pour les difficultés d'élocution.
Certains hôpitaux français proposent un service d'hôpital de jour, qui accueille les patients sur une journée. Ils peuvent ainsi en quelques heures rencontrer plusieurs spécialistes.
Traitements : ils ne s'attaquent qu'aux symptômes
À ce jour, on ne sait pas guérir la maladie de Parkinson. Les médicaments ne servent qu'à diminuer les symptômes.
Le traitement est en général constitué de plusieurs médicaments, la L-dopa et les agonistes dopaminergiques. Leur efficacité dure généralement de trois à huit ans, c'est ce que l'on appelle la "Lune de miel", avant la réapparition des symptômes pendant des périodes plus ou moins longues. Certains effets indésirables sont fréquemment induits par le traitement : il peut s'agir de nausées, de vomissements, de dyskinésies qui sont des mouvements anormaux, de troubles du comportement à type d'addiction aux jeux, à la sexualité, aux achats compulsifs, ou à l'alimentation avec le grignotage. En parler à son médecin permet d'ajuster le traitement
L'activité physique contre Parkinson
L'activité physique, partie intégrante de la prise en charge
Il est fréquent que les patients parkinsoniens adoptent un mode de vie moins actif du fait de la raideur des muscles, des troubles de l'équilibre, et de la fatigue qu'engendre la maladie. Pourtant, selon certaines études, le sport serait déterminant pour tempérer les difficultés motrices des malades et pourrait même stimuler temporairement la fabrication naturelle de dopamine dans le cerveau.
Il est donc primordial de maintenir son activité physique et surtout d'entretenir sa motricité grâce à la kinésithérapie, qui est un complément thérapeutique important, voire indispensable. La pratique régulière d'un sport peut conduire les médecins à réduire les doses de médicaments et aussi le nombre de prises.
La chirurgie : réservée aux cas les plus graves
La chirurgie ne s'adresse quà une minorité de patients.
Lorsque les symptômes ne sont plus ou mal corrigés par les traitements classiques, la chirurgie peut être une solution. Mais le traitement chirurgical, par stimulation profonde du cerveau, est réservé à 5 à10% des malades seulement, ceux qui souffrent d'une forme grave de la maladie.
Les indications sont précises : patient de moins de 70 ans, maladie qui a au moins 5 ans d'évolution, dont les symptômes moteurs ne sont pas trop importants, avec des troubles cognitifs ou psychiatriques peu développés, sans autre affection évolutive.
La méthode de stimulation profonde du cerveau consiste à implanter des électrodes dans chacun des deux noyaux subthalamiques (aires du cerveau associées à la motricité). Les stimulations électriques vont réguler l'activité excessive des neurones qui subsistent.
L'étape suivante a pour but de relier ces électrodes à des stimulateurs - deux boîtiers qui sont situés chacun sous une clavicule. C'est un peu l'équivalent d'un pacemaker pour le coeur, ce sont eux qui génèrent le courant envoyé vers les noyaux subthalamiques.
Même si les patients voient leur qualité de vie améliorée, l'électrostimulation n'empêche pas la maladie de progresser. Tous les 5 ans, une nouvelle opération est programmée pour changer la pile mais de nouvelles piles ont une durée de vie de 25 ans. Après ce traitement, les patients sont suivis pour vérifier l'efficacité du système sur ses symptômes.
Une étude menée notamment par une équipe de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, à Paris a montré que la stimulation cérébrale profonde pourrait être pratiquée de manière précoce, très rapidement après l'apparition des complications motrices, avec de bons résultats.
À lire aussi : Une chirurgie de pointe pour traiter la maladie de Parkinson
La pompe à apomorphine, en cas d'échec des traitements
L'effet des traitements devient parfois fluctuant au cours de la journée. Le patient présente des phases ON, où le médicament agit et les symptômes sont diminués, et des phases OFF, où ce n'est plus le cas. Lorsque les fluctuations se majorent et que les phases OFF sont prolongées, on peut proposer une pompe. Autre indication, lorsque le patient devient trop sensible au traitement et présente des "dyskinésies", des mouvements anormaux. L'âge n'est pas une limite, contrairement à la chirurgie, ce qui en fait une alternative en cas de contre-indication à l'intervention chirurgicale.
Avec la pompe à apomorphine, plus besoin d'avaler son traitement à heure fixe, il est délivré en permanence. Grâce à une aiguille, la pompe va automatiquement dispenser le médicament tout au long de la journée. Avec ce système d'injection sous cutané, en moins de dix minutes, l'apomorphine arrive au cerveau et contrôle en un délai très court les symptômes parkinsoniens.
"La pompe à apomorphine n'est pas un traitement que l'on propose au début de la maladie mais seulement au moment où il y a une perte d'efficacité des traitements oraux. Et au moment où cette efficacité devient discontinue sur la journée", explique le Dr Emmanuel Flamand-Roze, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. "Ainsi les patients peuvent espérer avoir un bénéfice plus continu d'un bout à l'autre de la journée, sans période de blocage et sans période de mouvements anormaux incontrôlés".
Avec ce traitement, la vie des patients est quasi normale même si la mise en place de cette pompe requiert la visite d'une infirmière deux fois par jour (la pompe est branchée le matin et retirée le soir). En apportant plus de confort aux malades, cette pompe permet aussi une meilleure observance du traitement. Les effets indésirables les plus fréquents sont des nodules sous-cutanés, suite aux injections.
En 2022, une étude a été publiée pour montrer que l'utilisation de la pompe à apomorphine permettait d'améliorer le sommeil et l'état de santé global.
A lire aussi : Parkinson, un traitement pour améliorer la qualité du sommeil
Parkinson : la thérapie génique, un espoir
La recherche est très active dans le domaine de la maladie de Parkison, avec des espoirs brutalement déçus comme avec la défériprone, qui était moins efficace que le placebo.
La thérapie génique comporte deux axes d'action : ralentir la progression de la maladie, grâce à des facteurs favorisant et protégeant les neurones. Les chercheurs se concentrent sur deux facteurs impliqués (le GNDF et le NTN).
Second axe de recherche : favoriser la dopamine, comme dans cet essai clinique mené par une équipe associant l'Inserm et l'l’hôpital Henri-Mondor de Créteil, et débuté en 2009. Il consiste alors à introduire dans l'organisme des gènes réparateurs, injectés dans une région du cerveau, appelée striatum, qui produit la dopamine. Ils s'introduisent dans les cellules du striatum, qui auront alors la capacité de produire de la dopamine de façon continue. Après une étude clinique pour évaluer l'efficacité et la tolérance du Prosavin® , d'autres travaux ont évalué l'efficacité. Les résultats apparaissent modérés d'après cette étude analysant les avancées thérapeutiques et nécessitent d'être approfondis.
A lire aussi : Parkinson, des avancées médicales considérables
Injections de dopamine, vaccin, cellules souches...
Parkinson : un nouveau traitement prometteur
Le Magazine de la Santé - France 5
Un autre essai clinique inédit appelé DIVE, actuellement en phase 2 s'intéresse aux injections de dopamine dans le cerveau. Ce traitement permettrait de diminuer les médicaments conventionnels et de limiter les effets indésirables.
L'immunothérapie est aussi une piste de recherche majeure contre la maladie de Parkinson. Un vaccin thérapeutique est à l'étude en Autriche et il lutterait contre les causes de la maladie.
Ce vaccin thérapeutique est appelé PDO1A. Son action : agir sur les causes de la maladie de Parkinson, et plus précisément sur une des protéines malades qui s'accumulent et détruisent les neurones. C'est l'alpha-synucléine
L'immunothérapie passive consiste donc à administrer un anticorps dont le rôle sera d'éliminer l'alpha-synucléine. nouveau vaccin mis au point par un laboratoire privé autrichien, Affiris.
Pour l'instant, le PD01A a montré des résultats prometteurs en phase 1 testant l'innocuité et la tolérance, sur 32 patients. Un suivi à long terme est en cours, ainsi qu'une deuxième et troisième vaccination de rappel.
Une autre piste de recherche réside dans les cellules souches pour obtenir des cellules capables de la dopamine. Des essais cliniques se poursuivent, comme celui baptisé TRANSEURO en cours.
En savoir plus
Sur Allodocteurs.fr
· Dix idées reçues sur la maladie de Parkinson
· Parkinson : les cauchemars sont-ils un signe de la maladie ?
· La maladie de Parkinson en cinq questions
· Une chirurgie de pointe pour traiter la maladie de Parkinson
· Maladie de Parkinson : un traitement pour améliorer la qualité du sommeil
· Parkinson : se rééduquer grâce... au paddle !
Ailleurs sur le web
· France Parkinson
· Inserm
· Fondation pour la Recherche Médicale
· Organisation mondiale de la Santé